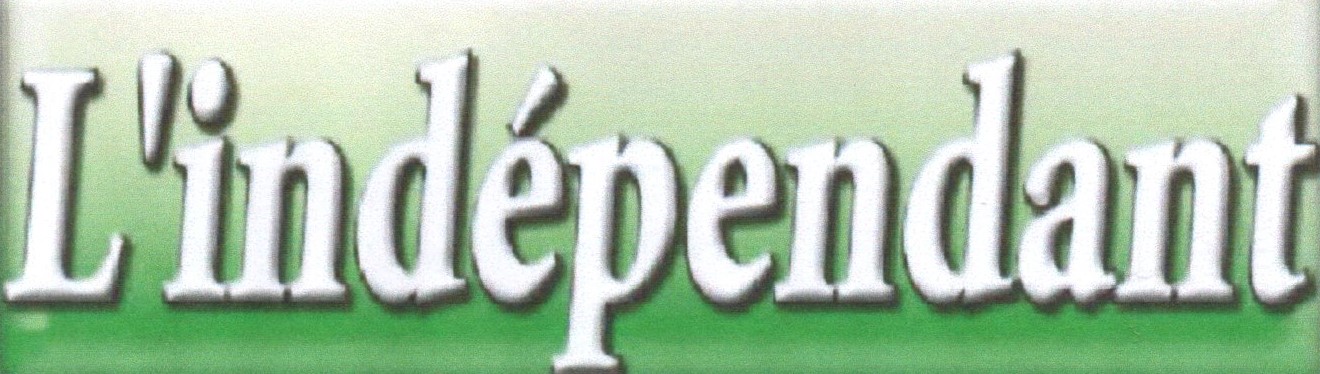Pendant plus de treize siècles, l’esclavage a façonné en profondeur les sociétés musulmanes, de l’Andalousie médiévale aux confins de l’océan Indien. Un pan de l’histoire souvent éclipsé par la mémoire dominante de la traite transatlantique. Pourtant, des millions d’Africains, d’Européens ou de Caucasiens ont été asservis dans l’espace islamique. Décryptage d’un tabou historique aux résonances contemporaines.
- Aux origines : conquêtes, captifs et empire
À peine le prophète Mahomet mort en 632, l’expansion arabo-musulmane débute. Et avec elle, les premières razzias. Dans leur marche vers l’est et l’ouest, les conquérants capturent des populations entières. Villes à bâtir, armées à entretenir, palais à servir : il faut de la main-d’œuvre. L’exemple est emblématique : en 652, un traité impose à la Nubie chrétienne de livrer 350 esclaves par an à l’Égypte musulmane. Ce système s’institutionnalise dès les Abbassides (VIIIe-XIIIe siècles), bâtisseurs d’un empire tentaculaire.
- L’islam ne bannit pas l’esclavage, il l’encadre
Comme le judaïsme ou le christianisme, l’islam n’abolit pas l’esclavage. Il le régule. Le Coran interdit de tuer un esclave, encourage l’affranchissement, protège les captives de certains abus. Mais le principe central – « un musulman ne peut asservir un autre musulman » – sera très souvent contourné. En théorie morale, l’islam vise à atténuer la violence de l’institution. En pratique, elle reste omniprésente.
- L’Afrique noire, principal réservoir de captifs
Contrairement à une idée reçue, la traite islamique ne repose pas sur une hiérarchie raciale stricte, mais sur la différence religieuse. Les régions non islamisées, notamment au sud du Sahara, deviennent la cible principale. Le Bilad al-Sudan, littéralement « pays des Noirs », approvisionne pendant des siècles les marchés aux esclaves du Maghreb, de l’Arabie ou du Moyen-Orient. Et même lorsque les royaumes africains se convertissent, les marchands trouvent des parades : « musulmans douteux », disent-ils.
- Une traite à l’échelle de trois continents
La traite arabo-musulmane s’étend du VIIe au début du XXe siècle. Les chiffres donnent le vertige :
- Transsaharienne : jusqu’à 9 millions de victimes
- Orientale (mer Rouge, océan Indien) : environ 7 millions
- Méditerranéenne : 850 000 Européens capturés par les corsaires barbaresques
- XIXe siècle : plus d’un million d’Ouest-Africains expédiés vers le Maghreb et l’Égypte
Un commerce massif, mais peu intégré aux récits historiques dominants.
- Esclaves d’élite, domestiques ou concubines
La majorité des esclaves mènent une vie domestique : cuisiniers, porteurs d’eau, eunuques, concubines. Mais d’autres, formés à la guerre ou à l’administration, intègrent les sphères du pouvoir. Certains deviennent généraux, voire souverains. Les mamelouks, esclaves militaires affranchis, prendront même le contrôle de l’Égypte et y établiront leur propre dynastie. Un paradoxe : de l’asservissement à la domination.
- Une ambivalence juridique troublante
Dans le monde musulman, l’esclave est à la fois bien mobilier et être humain doté de droits. Il peut hériter, se marier, acheter sa liberté. L’affranchissement est valorisé par la religion, surtout s’il s’accompagne d’une conversion sincère. Certaines femmes esclaves, mères d’enfants libres, deviennent même épouses légitimes. Une d’entre elles, Chajar al-Durr, règnera seule sur l’Égypte au XIIIe siècle.
- Des révoltes rares mais retentissantes
L’exemple le plus marquant : la révolte des Zanjs dans le sud de l’Irak (869-883). Ces esclaves noirs, utilisés pour assécher les marais, prennent les armes. Quatorze années de guérilla, des victoires militaires, des villes prises. Un traumatisme durable pour les élites abbassides. D’autres résistances passent par les tribunaux : au XIIIe siècle, le théologien Ibn Taymiyya libère des esclaves battus par un maître qu’il juge « hérétique ».
- Une abolition tardive, sous pression extérieure
Contrairement à l’Europe, l’abolition ne vient pas de l’intérieur. Elle s’impose sous la pression des puissances coloniales, notamment l’Angleterre.
- Empire ottoman : premières interdictions dès 1820
- Égypte, Iran, Irak, Afghanistan : abolition progressive au XIXe siècle
- Arabie saoudite : abolition officielle… en 1968
- Mauritanie : 1981, criminalisation en 2007 seulement
Et malgré cela, des formes contemporaines d’esclavage persistent, notamment en Afrique de l’Ouest.
Un tabou historique encore vivace
« On a longtemps cru que l’esclavage islamique était plus humain. C’est faux. »
— M’hamed Oualdi, historien
Le monde musulman n’a pas construit de plantations industrielles comme dans les Amériques, mais il a fondé des sociétés esclavagistes à part entière. Pourtant, cette mémoire reste marginalisée, voire niée. Une amnésie historique qui empêche encore aujourd’hui de penser sereinement les héritages de l’asservissement.
Source : Rfi